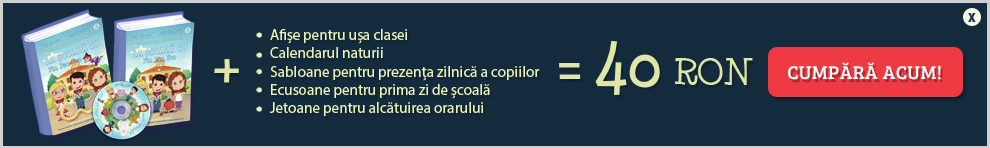Critiques de films, dossiers sur l’histoire du cinema, actus cine/DVD…
Continuant le travail commence ici puis la, voici la troisieme partie de notre reflexion sur les rapports etroits entre un objet, le dvd, et un concept, la cinephilie.
II. Le DVD, un nouveau rapport au film
A. Le descendant du Laserdisc
Pour parler du support DVD, il faut remonter quelques annees en arriere, jusqu’a l’avenement de la cassette video. Le support transformait le film en un objet qu’on pouvait tenir dans une main, garder, echanger. L’essor de la video donna naissance a une nouvelle industrie : la domestication du film, induisant de nouveaux usages cinephiliques en dehors de la salle de cinema. La seconde revolution des usages vint avec le premier support pense pour le cinephile : le Laserdisc. Lance en 1987, il s’eteindra une dizaine d’annees plus tard. Il avait pourtant certains arguments pour supplanter la VHS enregistree, qui furent repris par le DVD : en premier lieu une definition superieure de l’image, un son numerique et la possibilite de choisir entre la version francaise et la version originale. De plus, c’est avec ce support qu’est ne le concept du bonus. Le cinephile pouvait penetrer a l’interieur de l’univers du film, avec making-of, explications de toutes sortes, filmographies, etc.
D’imposantes barrieres se sont vite opposees a une reelle democratisation du support et finalement a son succes. Un prix prohibitif, un encombrement certain (le support avait la taille d’un disque vinyle 33 tours et le lecteur etait imposant), qui faisait aussi qu’un film a duree „standard” (autour de 2 heures) occupait les deux faces du disque, impliquant le changement en cours de visionnement. Bref, le Laserdisc, tout en faisant office de support cinephilique pionnier, devait etre supplante par une nouvelle revolution : le DVD.
Vous allez me dire, mais que vient faire Michael Jackson dans ces chroniques ? Plusieurs raisons me viennent a l’esprit, certaines plus personnelles que d’autres. Mais avant tout, on n’a rien compris si l’on pense que Michael Jackson n’etait pas un homme d’images. L’inventivite de ses clips, a commencer par le mythique Thriller (qui a marque la premiere incursion d’un artiste noir sur la chaine americaine MTV). La variete de ceux-ci, brassant tous les genres (attrait marque pour le fantastique, polar avec Smooth Criminal ou Bad, realise par Martin Scorsese, film d’animation avec Speed Demon, peplum pour l’egyptophile Remember the Time, sport avec Jam, et j’en oublie).
Le cinema etait tres important dans la demarche artistique de Michael Jackson, lui qui a toujours voulu se frayer un chemin vers les salles obscures sans vraiment y parvenir (qui se souvient de The Wiz, version noire du Magicien d’Oz avec Diana Ross en Dorothy, et l’on pourra dire sans peine que Moonwalker, film dedie a la promotion de son album Bad, est bien bancal, malgre quelques fulgurances. Mais certains de ses clips font clairement reference au processus de creation cinematographique, a commencer par Liberian Girl, qui voit un defile impressionnant de stars eighties, qui attendent tous la venue de Michael Jackson pour tourner un clip… La fin nous montre que Michael Jackson lui-meme etait derriere la camera pendant tout ce temps ! Richard Dreyfus, Steven Spielberg -et son fameux plan-signature travelling arriere-zoom avant, Whoopi Goldberg, Danny Glover, Dan Ayckroyd, bref la totale. Son exigence de l’image parfaite l’engage a aller voir des realisateurs renommes pour realiser ses clips, que ce soit John Landis (Le loup-garou de Londres) pour Thriller, Spike Lee (Do the right thing, Malcolm X, La 25e heure) pour They don’t care about us et meme David Fincher pour Who is it ?, avant son passage au long metrage.
L’enorme clip Black or White, concu pour lancer la promotion de l’album Dangerous, est un tour du monde qui devient par la un panorama du cinema, du western a la comedie Bollywood.
Au-dela des images, c’est evidemment par la musique qui les accompagne (melange de la soul noire et de la pop americaine, avec un soupcon d’avant-garde dans les arrangements musicaux, toujours au cordeau), epaule par une voix unique, que Michael Jackson s’est fait une place dans l’Histoire du 20e siecle. Sans conteste plus grand showman sur terre, ses trouvailles dansees remarquables (le moonwalk restera son mouvement le plus marquant, devenant la signature d’un style fin, et toujours domine par une dimension magique – voir son lean-over dans Smooth Criminal) survivront a tous ses successeurs ; bref, en meme temps qu’il disparait, avec lui s’efface un pan de l’histoire. Homme de tous les superlatifs, de tous les records (Thriller est l’album le plus vendu de tous les temps et, vu les ventes du monde du disque, le record ne risque pas de tomber de sitot), Michael Jackson semblait venu d’ailleurs. Un personnage de cinema. So long, MJ !
Wild Side Video nous fait decouvrir des pans plutot meconnus du cinema asiatique avec le coffret Tomu Uchida, sorti en 2006.
Ce film-ci, narrant la vie pleine de peripeties de Jirozaemon, abandonne a la naissance a cause d’une „horrible” tache sur la joue droite, marque une belle reussite de son auteur.
La premiere partie du film s’etend a caracteriser le handicap social de l’homme par rapport a sa marque disgracieuse ; malgre une reussite professionnelle sans conteste -il devient un prospere marchand de soie-, les qu’en dira-t-on ne cessent d’evoquer sa laideur, qui l’empeche, meme adulte, de trouver une epouse. L’homme est donc accable socialement par un defaut physique, malgre une qualite d’etre qui ne fait pas de doute. Uchida, pour signifier l’isolement du personnage, compose des cadres symetriques, symetrie que le visage de Jirozaemon ne connait pas. Sa mise a l’ecart sociale s’appuie sur un detachement visuel, le fond et la forme s’accordant d’une bien belle maniere. Alors que la majorite des plans font appel a une symetrie classique, donnant aux differents plans un eclat evident, le defaut de l’homme n’en ressort que plus.
La symetrie va ici de pair avec la beaute flamboyante d’un Scope couleurs extremement travaille : les tons sont quasi pastels, procurant a chaque image le ton doux des estampes japonaises ; on retrouve ici un autre contraste, entre le veloute des couleurs et la tonalite sombre du recit, annonce des le titre ; on ne trompe personne, cette histoire est un drame.
Un drame car encore une fois, le film s’ingenue a opposer deux situations qui vont etre le quotidien de Jirozaemon : alors qu’il est un marchand reconnu, faisant par ce biais partie de la bonne societe, sa quete d’une epouse va l’obliger a frequenter assidument les bordels de Yoshiwara, ou il tombe amoureux d’un prostituee, ancienne taularde qui s’est retrouvee la par obligation. S’oppose alors deux logiques, celle du travail -son entreprise de soie a besoin d’argent car les recoltes n’ont pas ete bonnes- et celle du plaisir -la fille de joie veut bien l’epouser s’il lui permet de devenir premiere courtisane, ce qui demande des fonds importants.
Le film, fonctionnant continuellement sur des extremes contradictoires, est de fait tres clairement construit. La trajectoire tragique du personnage principal, handicape des la premiere image, est terrible et s’expiera dans un final marquant. La sournoiserie de la jeune fille, aussi belle que vulgaire, repond a l’opportunisme des tenanciers des maisons closes, qui echafaudent sur le dos de Jirozaemon un plan pour lui soutirer encore plus d’argent. La force tragique du recit, accompagne par quelques fulgurances visuelles, est assez remarquable, surtout dans sa derniere partie. Avant cela, le debut nous aura paru tout de meme un peu long a se mettre en place. Une belle decouverte pour un cinema nippon toujours surprenant.
Ex-æquo avec Mary and Max (les jurys- et pas qu’eux- ne partageant pas notre reaction sur ce dernier film), est couronne cette annee le magnifique Coraline, fable adaptee d’un recit de Neil Gaiman (decidement dans tous les bons coups : Stardust et dernierement).
Rappelant a nos memoires les terreurs enfantines, le film tire sa force d’une unite assez exceptionnelle, oscillant entre emerveillement -certaines sequences sont d’ores et deja a classer dans les plus grands moments de l’histoire de l’animation, tel la danse du cirque des souris de M. Bobinski, la decouverte du jardin feerique imagine par l’Autre Mere- et frissons, lors des debordements finaux de cette fameuse Autre Mere. Il y a dans la facon d’explorer la typologie des decors une grace evidente, a base de travellings survolants, et de cadres captant toujours au mieux les expressions des personnages, autant que les etrangetes topographiques des lieux. Centre sur un trip a la Alice aux pays des merveilles, le film a la bonne idee de nous interesser aux deux mondes paralleles avec une meme intensite, ce qu’avait echoue a mettre en place les Noce funebres de Tim Burton, utilisant un dispositif similaire. La raison en est toute simple : durant le film, qui que nous soyons, nous sommes Coraline, nous vivons son aventure. Expliquer cela par A+B me parait impossible, et pour le coup inutile. Tel est le film, naissant d’une alchimie entre divers elements tels l’image, la musique, les voix, le fil des actions, les personnages…
Emerveillement versus (petite) frayeur, le cœur du film est dans l’opposition de deux mondes aussi fantastiques l’un que l’autre, et c’est surement la tout le sel de ce beau film. Le monde „ordinaire” de Coraline ne l’est pas le moins du monde. Entre un jeune garcon etrange (sa premiere apparition en fait un petit monstre), un puits -presque- sans fond, un domaine avec sa maison rosee absolument pas croyable, bref cette inquietante etrangete (qui habite assez souvent nos chroniques) est de mise des le premier plan. Le generique de debut est d’ailleurs un petit chef d’œuvre a lui tout seul, et qui, en alignant des images de jolies peluches puis d’une anonyme main crochue, fait deja de la duplicite thematique sa profession de foi.
Aller voir Coraline, c’est donc embarquer pour un voyage trouble au pays des songes hantes, et qui, personnellement, constitue ni plus ni moins ma plus belle experience cine de l’annee (n’oublions quand meme pas les qui m’ont carrement ensorceles).
J’assiste a la projection de ce long metrage avec une attente palpable, les antecedents du Monsieur ayant ete unanimement salues (Harvie Krumpet, Oscar 2003 du meilleur court d’animation).
Debute alors un film en demi-teintes, narrant la relation epistolaire de deux individus atteints de diverses nevroses (comme tout un chacun, en fait). Une jeune fille complexee et aux reperes mouvants donnes par son alcoolique de mere ; puis un vieil autiste obese. Une serie d’animation, Les Noblets, les relient indefectiblement, tous deux etant animes par une meme passion pour le show. Petit a petit se developpe donc ce lien special, a distance, accompagnant chacun dans leur vie de tous les jours. Sur ce canevas pour le moins interessant, vient malheureusement se greffer une esthetique morne, monochromatique, soutenu par le commentaire atonal d’un narrateur bavard (le casting vocal est d’ailleurs impressionnant, mais seulement sur le papier : Philip Seymour Hoffman, Toni Colette, Eric Bana). L’environnement sonore, clairement oppose entre les deux partis (enjoue pour Mary, desespere pour Max) est soigne, et certains passages musicaux sont de vraies reussites.
Deroulant certes une histoire touchante, pleine de bizarreries etonnantes -les hot dogs au chocolat du vieux Max, les deambulations et le look de mort-vivant de la mere imbibee de Mary-, le film reste cependant replie sur lui-meme, a l’image de l’affection qui touche Max. L’emotion peine a poindre devant tant de morosite. Il est donc permis de s’y ennuyer, voire meme d’eprouver une malaise correspondant a l’etat d’esprit des deux personnages. Le realisateur a-t-il reussi son coup ? Etait-ce la reaction escomptee ? Quoi qu’il en soit, ces impressions faconnent la deception qui nous etreint au sortir de la salle.
A quoi bon resider sur Annecy et ne pas assister a leur Festival du film d’animation de dimension internationale ? Cette annee encore, le programme est plutot allechant : Coraline (Henry Selick, present sur place) en competition, Mary et Max (Adam Elliot), Ghost in the Shell 2.0, le film seminal de Mamoru Oshii, agremente de nouveaux effets speciaux, ou Sword of the Stranger, prometteur film de sabre, bref, pour les longs, il y a de quoi faire.
D’abord, impossible de faire l’impasse sur le magnifique Cat Piano. La rencontre d’Edgar Poe et du film noir, saupoudree de l’esthetique de Guarnido pour la bede Blacksad. Tourne en Cinemascope, la signature visuelle est tres seduisante, misant beaucoup sur le clair obscur. Ambiance jazzy, quartiers chauds, le film deroule un feeling oscillant entre le cool et le macabre ; des chats se font enlever pour, peut-etre finir dans le fameux Cat Piano, soit une machine infernale qui fait correspondre a chaque touche de l’instrument la queue d’un chat ; cette derniere est alors comme poinconnee, et le chat de faire sortir toute sa gamme dans un miaulement qui glace le sang. Meme si l’histoire aurait pu etre plus complexe (l’affaire est close trop rapidement), on est vraiment devant un bon morceau de mise en scene ; de la belle ouvrage, sur la voix rauque de Nick Cave. En voici la belle bande annonce…
Autre tres bon cru de ce programme, le farouchement anti-capitaliste Train en folie, de Cordell Barker (Canada). Le train ne doit jamais manquer de charbon pour avancer, au mepris de toutes les morales, et au benefice unique des riches. Mais, alors que dans la vie, ces derniers en sortent toujours gagnants, remercies en prime avec un sacre paquet d’oseille en poche, la justice divine du film d’animation leur rend ici la monnaie de leur piece. Detonnant.
Pour finir, The Tale of little Pupettboy, alias Sagan om den lille dockpojken, de Johannes Nyholm, pour la Suede. Ces aventures rocambolesques d’un jeune garcon solitaire sont desopilantes, trash, desolantes, bref. Et la version tele d’Ivanhoe, avec James Mason, a ete partiellement recreee en images par images ! Il y a fort a parier qu’on retrouve l’un de ses trois films dans le palmares, a voir…
2. L’institutionnalisation francaise du cinema
a. La Cinematheque Francaise
Henri Langlois, avec l’aide de George Franju, cree la Cinematheque Francaise en 1936. Il s’agit d’une association loi 1901, d’initiative privee mais soutenue par l’Etat, qui est son principal financeur (a hauteur de 80 %). Elle est le premier geste institutionnel de reconnaissance politique du cinema en France. Elle a pour mission conservation et diffusion de films, qui representent un ensemble de 40 000 metrages. La passion de Langlois et son initiative sont unanimement reconnues dans le monde cinematographique comme un immense pas en avant pour la reconnaissance de cette forme artistique.
La Cinematheque Francaise est pour beaucoup dans la constitution du gout cinephilique. La valorisation de ses collections par des retrospectives, sa programmation et ses editions sont sans egal. Sans la Cinematheque, la generation des jeunes-turcs des Cahiers du Cinema n’aurait certainement pas vu le jour…
b. Le Centre National de la Cinematographie
Le CNC est un organisme public cree dans l’immediat apres-guerre, en 1947. Il est cense encadrer la production cinematographique nationale et la recenser. Il n’institue cependant dans un premier temps que le depot volontaire des films par leurs ayant-droits -les producteurs le plus souvent-, dans le souci de les proteger juridiquement. Le recensement sera donc d’abord partiel car facultatif. Alors que le copyright sur les œuvres filmiques aux Etats-Unis existe depuis 1912 (pour des raisons economiques), le depot legal francais date de 1977. Des lors, tous les films sortis sur le territoire seront repertories et conserves.
D’autre part, le Service des Archives du film du CNC a ete cree en 1969, apres que Langlois ait ete evince de la Cinematheque en fevrier 1968. Ce pole est un des hauts lieux de la restauration (environ 1000 œuvres par an), concernant les films bien sur, mais aussi le non-film : affiches, scenarios, materiel publicitaire. Le cercle digne de restauration s’elargit. Le film, partie prenante dans ces autres dimensions, devient un veritable univers. Element « solaire », il rayonne sur tous ses satellites qui forment finalement une galaxie-systeme indissociable.
Nous sommes au cœur de la cinephilie, mise en perspective permanente, qui touche a tous les domaines du film. Ici, la cinephilie se comprend comme besoin de savoir (et d’avoir) l’annexe pour mieux connaitre le principal.
Sam Raimi aura fait de tres beaux morceaux de cinema, au milieu d’autres beaucoup plus oubliables ; profitons de la sortie de son dernier film, Jusqu’en enfer, retour aux sources horrifique, pour brosser un tableau inegal de la suite que forme Spider-Man 2 et 3 ; le 2 incarnant la reussite la plus evidente autant que le 3 reste une grosse tache sur l’edifice de sa trilogie. Depuis la sortie de son Evil Dead (1983), il a signe une œuvre fun, gore, follement inventive, parcourue de travellings monstrueux, d’effets grand-guignolesques (les Evil Dead justement, ainsi que son premier et genial film de super-heros, Darkman, realise en 1990), de purs moments de terreur, mais aussi de moments plus calmes etonnamment reussis (Un plan simple, 1998), pour le prix de films plus quelconques (Mort ou vif, 1995, Pour l’amour du jeu, 1999, Intuitions, 2000). Tout cela pour arriver a Spider-Man (2002), son reve de fan-boy (et celui de millions de jeunes a travers le monde), premier episode tout bonnement enthousiasmant, tant il donne corps a une vision definitive du personnage -et ce, malgre des problemes reels, tel le costume peu reussi du Bouffon Vert, et a son interpretation sympathique mais, au demeurant, assez unilaterale.
Concu comme un grand ride de montagnes russes, a l’image des multiples ballades aeriennes de son heros, relaye dans les moments depourvus d’action par un humour ravageur, Spider-Man 2 a tout de la suite parfaite. D’une facon amusante, il constitue souvent un remake du premier (comme l’etait Evil Dead 2 pour son modele), le tout en mieux. Les deux bad guys (Harry Osborn et Otto Octavius) sont tous deux des scientifiques qui pensaient œuvrer pour le bien de la communaute (activant comme toujours, il est vrai, ce bon vieux ressort du savant fou, nemesis tout trouve des super-heros), on remplace la decouverte de ses pouvoirs par Peter Parker par leur perte, ainsi que l’on retrouve le sauvetage dans l’immeuble en feu, etc. Mais le deuxieme episode adjoint a cette reproduction un supplement d’ame notable. Otto Octavius est ainsi un personnage traite plus en finesse, moins „mechant monobloc” que ne l’etait Harry Osborn / le Bouffon Vert. Plein de bonte, mais aussi d’une reelle ambition, il sera pris en defaut par sa trop grande confiance en lui. La relation qu’il entretient avec Parker, pleine de respect, voire quasi-filiale, sous-tendait egalement le recit du premier opus.
Alors que le deuxieme episode propose une confrontation simple mais entiere entre deux personnages forts, avec quelques sous-intrigues aidant a faire rebondir les peripeties -pensons notamment au proprietaire de l’appartement de Parker et a sa fille, terriblement attachants. De meme, toutes les tentatives humoristiques sont reussies, meme celles qui pouvaient etre casse-gueule, a la limite ; representative de cet etat, la sequence musicale sur „Raindrops Keep Falling on My Head”, de Burt Bacharach et Hal David, qui passe car le spectateur est cramponne au personnage, implique dans son envie de changement. La, Spider-man 2 opere une mini-revolution, et est alle la ou le premier film ne se serait jamais risque, pour gagner le jackpot. Refaire cela dans l’enorme machine incontrolable qu’est Spider-Man 3, c’etait aller… trop loin. En effet, on retrouve une sequence analogue, qui arrive au meme moment, lors d’une remise en question de la position de notre heros ; sauf que la, au milieu d’une musique aussi hors sujet que les dehanchements tres „dancefloor-friendly” d’un Tobey Maguire en roue libre, on est oblige de lacher totalement notre adhesion au personnage. La scission est consommee entre le spectateur et celui qui symbolisait sa prolongation fantasmee, faite d’un melange subtil de force morale, de faiblesse surtout, ainsi que d’une certaine naivete. Le 3 est d’ailleurs loin d’etre fun, et c’est a mon sens ce qui plombe le film. A l’image de la lente voire quasi-impossible reconnexion entre Peter et Mary-Jane, tout, dans Spider-Man 3 est laborieux.
Laborieux, la construction d’un scenario qui doit presenter autant de personnages importants (Sandman, Venom, New Goblin) qu’elle en oublie d’embarquer les spectateurs avec elle. Il est tout de meme terrible de voir que Sam Raimi ne voulait absolument pas de Venom dans son film -il aura ete oblige par le producteur Avi Arad-, et que ce dernier parasite litteralement tout le recit. Mais tout n’est pas la faute de Venom…
Des elements presents dans les autres films de la trilogie, sont renforces ici et ce, pour un resultat n’appelant aucune reserve : navrant. La religion, chantre de la difference entre le bien et le mal (dans le premier film, la toute premiere replique d’oncle Ben est bien „Dieu a dit que la lumiere soit, et la lumiere fut”, cela ne passe pas inapercu ; Tante May, plus tard, terrorise par le Bouffon Vert, recitera un bon petit Notre Pere de derriere les fagots, sans compter les multiples visites au cimetiere accompagnees a chaque occurrence par un sermon sans equivoque), est bien plus present dans le troisieme opus, notamment a travers la sequence dite „de l’eglise”, ou le pauvre Eddie Brock vient se repentir de ces peches (une photo retouchee sur Photoshop pour gagner une place de salarie dans le Daily Bugle… non mais ! ), et ou il sera contamine par le symbiote.
De meme, le patriotisme se fera plus exacerbe dans le 3, a coup de drapeaux americains plantes un peu partout, et de cette foi indefectible en la puissance de celui qui vient sauver tout le monde (qui a dit interventionnisme ?). Ne surnage finalement dans cette bouillie bien-pensante que la naissance du Sandman, en plan-sequence entierement numerique mais tout a fait touchant. Le passage semble le seul a avoir survecu a la tornade de Venom, qui semble bien avoir ete le declencheur d’un film-monstre, loin de la reussite eclatante du deuxieme episode. Alors, vive les suites ! (enfin, ca depend lesquelles).
Read the article on Le film était presque parfait
Le film etait presque parfait
Critiques de films, dossiers sur l’histoire du cinema, actus cine/DVD…
Continuant le travail commence ici puis la, voici la troisieme partie de notre reflexion sur les rapports etroits entre un objet, le dvd, et un concept, la cinephilie.
II. Le DVD, un nouveau rapport au film
A. Le descendant du Laserdisc
Pour parler du support DVD, il faut remonter quelques annees en arriere, jusqu’a l’avenement de la cassette video. Le support transformait le film en un objet qu’on pouvait tenir dans une main, garder, echanger. L’essor de la video donna naissance a une nouvelle industrie : la domestication du film, induisant de nouveaux usages cinephiliques en dehors de la salle de cinema. La seconde revolution des usages vint avec le premier support pense pour le cinephile : le Laserdisc. Lance en 1987, il s’eteindra une dizaine d’annees plus tard. Il avait pourtant certains arguments pour supplanter la VHS enregistree, qui furent repris par le DVD : en premier lieu une definition superieure de l’image, un son numerique et la possibilite de choisir entre la version francaise et la version originale. De plus, c’est avec ce support qu’est ne le concept du bonus. Le cinephile pouvait penetrer a l’interieur de l’univers du film, avec making-of, explications de toutes sortes, filmographies, etc.
D’imposantes barrieres se sont vite opposees a une reelle democratisation du support et finalement a son succes. Un prix prohibitif, un encombrement certain (le support avait la taille d’un disque vinyle 33 tours et le lecteur etait imposant), qui faisait aussi qu’un film a duree „standard” (autour de 2 heures) occupait les deux faces du disque, impliquant le changement en cours de visionnement. Bref, le Laserdisc, tout en faisant office de support cinephilique pionnier, devait etre supplante par une nouvelle revolution : le DVD.
Vous allez me dire, mais que vient faire Michael Jackson dans ces chroniques ? Plusieurs raisons me viennent a l’esprit, certaines plus personnelles que d’autres. Mais avant tout, on n’a rien compris si l’on pense que Michael Jackson n’etait pas un homme d’images. L’inventivite de ses clips, a commencer par le mythique Thriller (qui a marque la premiere incursion d’un artiste noir sur la chaine americaine MTV). La variete de ceux-ci, brassant tous les genres (attrait marque pour le fantastique, polar avec Smooth Criminal ou Bad, realise par Martin Scorsese, film d’animation avec Speed Demon, peplum pour l’egyptophile Remember the Time, sport avec Jam, et j’en oublie).
Le cinema etait tres important dans la demarche artistique de Michael Jackson, lui qui a toujours voulu se frayer un chemin vers les salles obscures sans vraiment y parvenir (qui se souvient de The Wiz, version noire du Magicien d’Oz avec Diana Ross en Dorothy, et l’on pourra dire sans peine que Moonwalker, film dedie a la promotion de son album Bad, est bien bancal, malgre quelques fulgurances. Mais certains de ses clips font clairement reference au processus de creation cinematographique, a commencer par Liberian Girl, qui voit un defile impressionnant de stars eighties, qui attendent tous la venue de Michael Jackson pour tourner un clip… La fin nous montre que Michael Jackson lui-meme etait derriere la camera pendant tout ce temps ! Richard Dreyfus, Steven Spielberg -et son fameux plan-signature travelling arriere-zoom avant, Whoopi Goldberg, Danny Glover, Dan Ayckroyd, bref la totale. Son exigence de l’image parfaite l’engage a aller voir des realisateurs renommes pour realiser ses clips, que ce soit John Landis (Le loup-garou de Londres) pour Thriller, Spike Lee (Do the right thing, Malcolm X, La 25e heure) pour They don’t care about us et meme David Fincher pour Who is it ?, avant son passage au long metrage.
L’enorme clip Black or White, concu pour lancer la promotion de l’album Dangerous, est un tour du monde qui devient par la un panorama du cinema, du western a la comedie Bollywood.
Au-dela des images, c’est evidemment par la musique qui les accompagne (melange de la soul noire et de la pop americaine, avec un soupcon d’avant-garde dans les arrangements musicaux, toujours au cordeau), epaule par une voix unique, que Michael Jackson s’est fait une place dans l’Histoire du 20e siecle. Sans conteste plus grand showman sur terre, ses trouvailles dansees remarquables (le moonwalk restera son mouvement le plus marquant, devenant la signature d’un style fin, et toujours domine par une dimension magique – voir son lean-over dans Smooth Criminal) survivront a tous ses successeurs ; bref, en meme temps qu’il disparait, avec lui s’efface un pan de l’histoire. Homme de tous les superlatifs, de tous les records (Thriller est l’album le plus vendu de tous les temps et, vu les ventes du monde du disque, le record ne risque pas de tomber de sitot), Michael Jackson semblait venu d’ailleurs. Un personnage de cinema. So long, MJ !
Wild Side Video nous fait decouvrir des pans plutot meconnus du cinema asiatique avec le coffret Tomu Uchida, sorti en 2006.
Ce film-ci, narrant la vie pleine de peripeties de Jirozaemon, abandonne a la naissance a cause d’une „horrible” tache sur la joue droite, marque une belle reussite de son auteur.
La premiere partie du film s’etend a caracteriser le handicap social de l’homme par rapport a sa marque disgracieuse ; malgre une reussite professionnelle sans conteste -il devient un prospere marchand de soie-, les qu’en dira-t-on ne cessent d’evoquer sa laideur, qui l’empeche, meme adulte, de trouver une epouse. L’homme est donc accable socialement par un defaut physique, malgre une qualite d’etre qui ne fait pas de doute. Uchida, pour signifier l’isolement du personnage, compose des cadres symetriques, symetrie que le visage de Jirozaemon ne connait pas. Sa mise a l’ecart sociale s’appuie sur un detachement visuel, le fond et la forme s’accordant d’une bien belle maniere. Alors que la majorite des plans font appel a une symetrie classique, donnant aux differents plans un eclat evident, le defaut de l’homme n’en ressort que plus.
La symetrie va ici de pair avec la beaute flamboyante d’un Scope couleurs extremement travaille : les tons sont quasi pastels, procurant a chaque image le ton doux des estampes japonaises ; on retrouve ici un autre contraste, entre le veloute des couleurs et la tonalite sombre du recit, annonce des le titre ; on ne trompe personne, cette histoire est un drame.
Un drame car encore une fois, le film s’ingenue a opposer deux situations qui vont etre le quotidien de Jirozaemon : alors qu’il est un marchand reconnu, faisant par ce biais partie de la bonne societe, sa quete d’une epouse va l’obliger a frequenter assidument les bordels de Yoshiwara, ou il tombe amoureux d’un prostituee, ancienne taularde qui s’est retrouvee la par obligation. S’oppose alors deux logiques, celle du travail -son entreprise de soie a besoin d’argent car les recoltes n’ont pas ete bonnes- et celle du plaisir -la fille de joie veut bien l’epouser s’il lui permet de devenir premiere courtisane, ce qui demande des fonds importants.
Le film, fonctionnant continuellement sur des extremes contradictoires, est de fait tres clairement construit. La trajectoire tragique du personnage principal, handicape des la premiere image, est terrible et s’expiera dans un final marquant. La sournoiserie de la jeune fille, aussi belle que vulgaire, repond a l’opportunisme des tenanciers des maisons closes, qui echafaudent sur le dos de Jirozaemon un plan pour lui soutirer encore plus d’argent. La force tragique du recit, accompagne par quelques fulgurances visuelles, est assez remarquable, surtout dans sa derniere partie. Avant cela, le debut nous aura paru tout de meme un peu long a se mettre en place. Une belle decouverte pour un cinema nippon toujours surprenant.
Ex-æquo avec Mary and Max (les jurys- et pas qu’eux- ne partageant pas notre reaction sur ce dernier film), est couronne cette annee le magnifique Coraline, fable adaptee d’un recit de Neil Gaiman (decidement dans tous les bons coups : Stardust et dernierement).
Rappelant a nos memoires les terreurs enfantines, le film tire sa force d’une unite assez exceptionnelle, oscillant entre emerveillement -certaines sequences sont d’ores et deja a classer dans les plus grands moments de l’histoire de l’animation, tel la danse du cirque des souris de M. Bobinski, la decouverte du jardin feerique imagine par l’Autre Mere- et frissons, lors des debordements finaux de cette fameuse Autre Mere. Il y a dans la facon d’explorer la typologie des decors une grace evidente, a base de travellings survolants, et de cadres captant toujours au mieux les expressions des personnages, autant que les etrangetes topographiques des lieux. Centre sur un trip a la Alice aux pays des merveilles, le film a la bonne idee de nous interesser aux deux mondes paralleles avec une meme intensite, ce qu’avait echoue a mettre en place les Noce funebres de Tim Burton, utilisant un dispositif similaire. La raison en est toute simple : durant le film, qui que nous soyons, nous sommes Coraline, nous vivons son aventure. Expliquer cela par A+B me parait impossible, et pour le coup inutile. Tel est le film, naissant d’une alchimie entre divers elements tels l’image, la musique, les voix, le fil des actions, les personnages…
Emerveillement versus (petite) frayeur, le cœur du film est dans l’opposition de deux mondes aussi fantastiques l’un que l’autre, et c’est surement la tout le sel de ce beau film. Le monde „ordinaire” de Coraline ne l’est pas le moins du monde. Entre un jeune garcon etrange (sa premiere apparition en fait un petit monstre), un puits -presque- sans fond, un domaine avec sa maison rosee absolument pas croyable, bref cette inquietante etrangete (qui habite assez souvent nos chroniques) est de mise des le premier plan. Le generique de debut est d’ailleurs un petit chef d’œuvre a lui tout seul, et qui, en alignant des images de jolies peluches puis d’une anonyme main crochue, fait deja de la duplicite thematique sa profession de foi.
Aller voir Coraline, c’est donc embarquer pour un voyage trouble au pays des songes hantes, et qui, personnellement, constitue ni plus ni moins ma plus belle experience cine de l’annee (n’oublions quand meme pas les qui m’ont carrement ensorceles).
J’assiste a la projection de ce long metrage avec une attente palpable, les antecedents du Monsieur ayant ete unanimement salues (Harvie Krumpet, Oscar 2003 du meilleur court d’animation).
Debute alors un film en demi-teintes, narrant la relation epistolaire de deux individus atteints de diverses nevroses (comme tout un chacun, en fait). Une jeune fille complexee et aux reperes mouvants donnes par son alcoolique de mere ; puis un vieil autiste obese. Une serie d’animation, Les Noblets, les relient indefectiblement, tous deux etant animes par une meme passion pour le show. Petit a petit se developpe donc ce lien special, a distance, accompagnant chacun dans leur vie de tous les jours. Sur ce canevas pour le moins interessant, vient malheureusement se greffer une esthetique morne, monochromatique, soutenu par le commentaire atonal d’un narrateur bavard (le casting vocal est d’ailleurs impressionnant, mais seulement sur le papier : Philip Seymour Hoffman, Toni Colette, Eric Bana). L’environnement sonore, clairement oppose entre les deux partis (enjoue pour Mary, desespere pour Max) est soigne, et certains passages musicaux sont de vraies reussites.
Deroulant certes une histoire touchante, pleine de bizarreries etonnantes -les hot dogs au chocolat du vieux Max, les deambulations et le look de mort-vivant de la mere imbibee de Mary-, le film reste cependant replie sur lui-meme, a l’image de l’affection qui touche Max. L’emotion peine a poindre devant tant de morosite. Il est donc permis de s’y ennuyer, voire meme d’eprouver une malaise correspondant a l’etat d’esprit des deux personnages. Le realisateur a-t-il reussi son coup ? Etait-ce la reaction escomptee ? Quoi qu’il en soit, ces impressions faconnent la deception qui nous etreint au sortir de la salle.
A quoi bon resider sur Annecy et ne pas assister a leur Festival du film d’animation de dimension internationale ? Cette annee encore, le programme est plutot allechant : Coraline (Henry Selick, present sur place) en competition, Mary et Max (Adam Elliot), Ghost in the Shell 2.0, le film seminal de Mamoru Oshii, agremente de nouveaux effets speciaux, ou Sword of the Stranger, prometteur film de sabre, bref, pour les longs, il y a de quoi faire.
D’abord, impossible de faire l’impasse sur le magnifique Cat Piano. La rencontre d’Edgar Poe et du film noir, saupoudree de l’esthetique de Guarnido pour la bede Blacksad. Tourne en Cinemascope, la signature visuelle est tres seduisante, misant beaucoup sur le clair obscur. Ambiance jazzy, quartiers chauds, le film deroule un feeling oscillant entre le cool et le macabre ; des chats se font enlever pour, peut-etre finir dans le fameux Cat Piano, soit une machine infernale qui fait correspondre a chaque touche de l’instrument la queue d’un chat ; cette derniere est alors comme poinconnee, et le chat de faire sortir toute sa gamme dans un miaulement qui glace le sang. Meme si l’histoire aurait pu etre plus complexe (l’affaire est close trop rapidement), on est vraiment devant un bon morceau de mise en scene ; de la belle ouvrage, sur la voix rauque de Nick Cave. En voici la belle bande annonce…
Autre tres bon cru de ce programme, le farouchement anti-capitaliste Train en folie, de Cordell Barker (Canada). Le train ne doit jamais manquer de charbon pour avancer, au mepris de toutes les morales, et au benefice unique des riches. Mais, alors que dans la vie, ces derniers en sortent toujours gagnants, remercies en prime avec un sacre paquet d’oseille en poche, la justice divine du film d’animation leur rend ici la monnaie de leur piece. Detonnant.
Pour finir, The Tale of little Pupettboy, alias Sagan om den lille dockpojken, de Johannes Nyholm, pour la Suede. Ces aventures rocambolesques d’un jeune garcon solitaire sont desopilantes, trash, desolantes, bref. Et la version tele d’Ivanhoe, avec James Mason, a ete partiellement recreee en images par images ! Il y a fort a parier qu’on retrouve l’un de ses trois films dans le palmares, a voir…
2. L’institutionnalisation francaise du cinema
a. La Cinematheque Francaise
Henri Langlois, avec l’aide de George Franju, cree la Cinematheque Francaise en 1936. Il s’agit d’une association loi 1901, d’initiative privee mais soutenue par l’Etat, qui est son principal financeur (a hauteur de 80 %). Elle est le premier geste institutionnel de reconnaissance politique du cinema en France. Elle a pour mission conservation et diffusion de films, qui representent un ensemble de 40 000 metrages. La passion de Langlois et son initiative sont unanimement reconnues dans le monde cinematographique comme un immense pas en avant pour la reconnaissance de cette forme artistique.
La Cinematheque Francaise est pour beaucoup dans la constitution du gout cinephilique. La valorisation de ses collections par des retrospectives, sa programmation et ses editions sont sans egal. Sans la Cinematheque, la generation des jeunes-turcs des Cahiers du Cinema n’aurait certainement pas vu le jour…
b. Le Centre National de la Cinematographie
Le CNC est un organisme public cree dans l’immediat apres-guerre, en 1947. Il est cense encadrer la production cinematographique nationale et la recenser. Il n’institue cependant dans un premier temps que le depot volontaire des films par leurs ayant-droits -les producteurs le plus souvent-, dans le souci de les proteger juridiquement. Le recensement sera donc d’abord partiel car facultatif. Alors que le copyright sur les œuvres filmiques aux Etats-Unis existe depuis 1912 (pour des raisons economiques), le depot legal francais date de 1977. Des lors, tous les films sortis sur le territoire seront repertories et conserves.
D’autre part, le Service des Archives du film du CNC a ete cree en 1969, apres que Langlois ait ete evince de la Cinematheque en fevrier 1968. Ce pole est un des hauts lieux de la restauration (environ 1000 œuvres par an), concernant les films bien sur, mais aussi le non-film : affiches, scenarios, materiel publicitaire. Le cercle digne de restauration s’elargit. Le film, partie prenante dans ces autres dimensions, devient un veritable univers. Element « solaire », il rayonne sur tous ses satellites qui forment finalement une galaxie-systeme indissociable.
Nous sommes au cœur de la cinephilie, mise en perspective permanente, qui touche a tous les domaines du film. Ici, la cinephilie se comprend comme besoin de savoir (et d’avoir) l’annexe pour mieux connaitre le principal.
Sam Raimi aura fait de tres beaux morceaux de cinema, au milieu d’autres beaucoup plus oubliables ; profitons de la sortie de son dernier film, Jusqu’en enfer, retour aux sources horrifique, pour brosser un tableau inegal de la suite que forme Spider-Man 2 et 3 ; le 2 incarnant la reussite la plus evidente autant que le 3 reste une grosse tache sur l’edifice de sa trilogie. Depuis la sortie de son Evil Dead (1983), il a signe une œuvre fun, gore, follement inventive, parcourue de travellings monstrueux, d’effets grand-guignolesques (les Evil Dead justement, ainsi que son premier et genial film de super-heros, Darkman, realise en 1990), de purs moments de terreur, mais aussi de moments plus calmes etonnamment reussis (Un plan simple, 1998), pour le prix de films plus quelconques (Mort ou vif, 1995, Pour l’amour du jeu, 1999, Intuitions, 2000). Tout cela pour arriver a Spider-Man (2002), son reve de fan-boy (et celui de millions de jeunes a travers le monde), premier episode tout bonnement enthousiasmant, tant il donne corps a une vision definitive du personnage -et ce, malgre des problemes reels, tel le costume peu reussi du Bouffon Vert, et a son interpretation sympathique mais, au demeurant, assez unilaterale.
Concu comme un grand ride de montagnes russes, a l’image des multiples ballades aeriennes de son heros, relaye dans les moments depourvus d’action par un humour ravageur, Spider-Man 2 a tout de la suite parfaite. D’une facon amusante, il constitue souvent un remake du premier (comme l’etait Evil Dead 2 pour son modele), le tout en mieux. Les deux bad guys (Harry Osborn et Otto Octavius) sont tous deux des scientifiques qui pensaient œuvrer pour le bien de la communaute (activant comme toujours, il est vrai, ce bon vieux ressort du savant fou, nemesis tout trouve des super-heros), on remplace la decouverte de ses pouvoirs par Peter Parker par leur perte, ainsi que l’on retrouve le sauvetage dans l’immeuble en feu, etc. Mais le deuxieme episode adjoint a cette reproduction un supplement d’ame notable. Otto Octavius est ainsi un personnage traite plus en finesse, moins „mechant monobloc” que ne l’etait Harry Osborn / le Bouffon Vert. Plein de bonte, mais aussi d’une reelle ambition, il sera pris en defaut par sa trop grande confiance en lui. La relation qu’il entretient avec Parker, pleine de respect, voire quasi-filiale, sous-tendait egalement le recit du premier opus.
Alors que le deuxieme episode propose une confrontation simple mais entiere entre deux personnages forts, avec quelques sous-intrigues aidant a faire rebondir les peripeties -pensons notamment au proprietaire de l’appartement de Parker et a sa fille, terriblement attachants. De meme, toutes les tentatives humoristiques sont reussies, meme celles qui pouvaient etre casse-gueule, a la limite ; representative de cet etat, la sequence musicale sur „Raindrops Keep Falling on My Head”, de Burt Bacharach et Hal David, qui passe car le spectateur est cramponne au personnage, implique dans son envie de changement. La, Spider-man 2 opere une mini-revolution, et est alle la ou le premier film ne se serait jamais risque, pour gagner le jackpot. Refaire cela dans l’enorme machine incontrolable qu’est Spider-Man 3, c’etait aller… trop loin. En effet, on retrouve une sequence analogue, qui arrive au meme moment, lors d’une remise en question de la position de notre heros ; sauf que la, au milieu d’une musique aussi hors sujet que les dehanchements tres „dancefloor-friendly” d’un Tobey Maguire en roue libre, on est oblige de lacher totalement notre adhesion au personnage. La scission est consommee entre le spectateur et celui qui symbolisait sa prolongation fantasmee, faite d’un melange subtil de force morale, de faiblesse surtout, ainsi que d’une certaine naivete. Le 3 est d’ailleurs loin d’etre fun, et c’est a mon sens ce qui plombe le film. A l’image de la lente voire quasi-impossible reconnexion entre Peter et Mary-Jane, tout, dans Spider-Man 3 est laborieux.
Laborieux, la construction d’un scenario qui doit presenter autant de personnages importants (Sandman, Venom, New Goblin) qu’elle en oublie d’embarquer les spectateurs avec elle. Il est tout de meme terrible de voir que Sam Raimi ne voulait absolument pas de Venom dans son film -il aura ete oblige par le producteur Avi Arad-, et que ce dernier parasite litteralement tout le recit. Mais tout n’est pas la faute de Venom…
Des elements presents dans les autres films de la trilogie, sont renforces ici et ce, pour un resultat n’appelant aucune reserve : navrant. La religion, chantre de la difference entre le bien et le mal (dans le premier film, la toute premiere replique d’oncle Ben est bien „Dieu a dit que la lumiere soit, et la lumiere fut”, cela ne passe pas inapercu ; Tante May, plus tard, terrorise par le Bouffon Vert, recitera un bon petit Notre Pere de derriere les fagots, sans compter les multiples visites au cimetiere accompagnees a chaque occurrence par un sermon sans equivoque), est bien plus present dans le troisieme opus, notamment a travers la sequence dite „de l’eglise”, ou le pauvre Eddie Brock vient se repentir de ces peches (une photo retouchee sur Photoshop pour gagner une place de salarie dans le Daily Bugle… non mais ! ), et ou il sera contamine par le symbiote.
De meme, le patriotisme se fera plus exacerbe dans le 3, a coup de drapeaux americains plantes un peu partout, et de cette foi indefectible en la puissance de celui qui vient sauver tout le monde (qui a dit interventionnisme ?). Ne surnage finalement dans cette bouillie bien-pensante que la naissance du Sandman, en plan-sequence entierement numerique mais tout a fait touchant. Le passage semble le seul a avoir survecu a la tornade de Venom, qui semble bien avoir ete le declencheur d’un film-monstre, loin de la reussite eclatante du deuxieme episode. Alors, vive les suites ! (enfin, ca depend lesquelles).